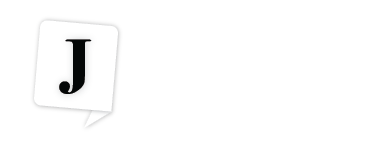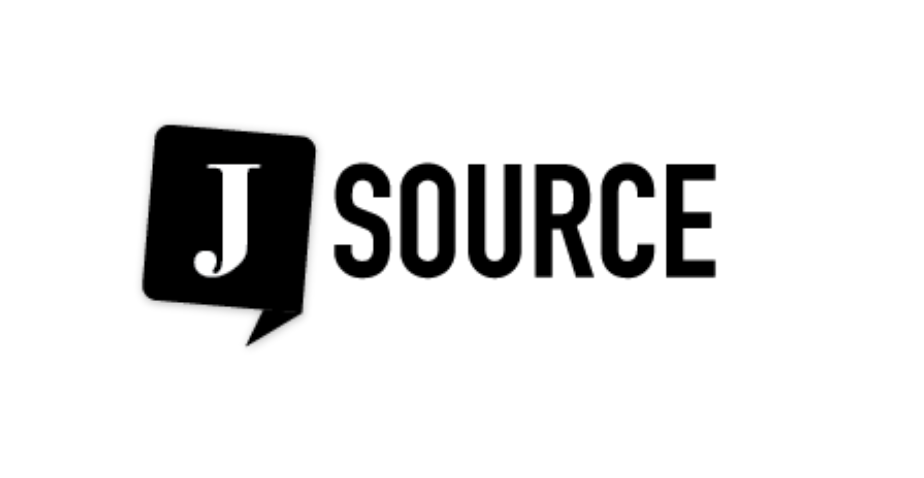La FPJQ taxée de corporatisme
De passage à Gatineau aujourd'hui, la consultation publique sur l'information d'intérêt public dans les médias bât son plein. Elle faisait escale à Québec vendredi et à Gaspé il y a deux semaines. Dans ces deux villes, les sections régionales de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) se sont présentées leur mémoire sous le bras pour plaider pour l’instauration d'un titre professionnel de journaliste gérer par leur fédération. Mais vendredi, la ministre Christine Saint-Pierre a déploré l'«attitude de fermeture de la FPJQ».
De passage à Gatineau aujourd'hui, la consultation publique sur l'information d'intérêt public dans les médias bât son plein. Elle faisait escale à Québec vendredi et à Gaspé il y a deux semaines. Dans ces deux villes, les sections régionales de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) se sont présentées leur mémoire sous le bras pour plaider pour l’instauration d'un titre professionnel de journaliste gérer par leur fédération. Mais vendredi, la ministre Christine Saint-Pierre a déploré l'«attitude de fermeture de la FPJQ».
«On nous a taxés de faire preuve de corporatisme», rapporte le journaliste indépendant Alain Castonguay qui présentait le mémoire de la section Québec de la fédération avec sa collègue du Soleil Valérie Gaudreau. La ministre réagissait ainsi à l'action concertée des sections régionales de la FPJQ pour s'opposer à la création d'une nouvelle structure de gestion du titre professionnel. «La FPJQ-Québec ne voit pas l’utilité de créer un nouvel organisme pour s’occuper d’une telle responsabilité. Cela ne ferait qu’alourdir la procédure simplifiée qui existe déjà pour déterminer les règles d’adhésion à la FPJQ», peut-on en effet lire dans le mémoire présenté vendredi.
Le rapport Payette, qui a inspiré la consultation en cours, va d'ailleurs dans le même sens puisqu'il propose la création d'une structure de gestion du titre relevant de la FPJQ et recommande même que l'organisme bénéficie d'une aide financière pour jouer ce rôle. Il propose que 25% du budget annuel du Fonds pour le journalisme québécois, créer en utilisant une partie de la TVQ sur la vente de journaux, lui soit versé, soit une enveloppe annuelle de 100 000 dollars.
Le mémoire de la FPJQ-Québec réitère également la frilosité de la fédération à l'égard du processus de consultation publique: «nous ne voyons pas l’utilité de consulter l’ensemble de la population sur une question qui concerne d’abord et avant tout les artisans du métier», peut-on y lire. À ce chapitre, la professeure Dominique Payette n'est pas d'accord. «Les journalistes tiennent à définir eux-mêmes le journalisme, mais là on discute de comment le journalisme s'inscrit dans la société. Les citoyens ont leur mot à dire là-dessus, surtout si l'État puise dans les fonds publics pour venir en aide à l'information», expliquait-elle à ProjetJ en août.
Le professeur Marc-François Bernier, qui a lui aussi défendu son mémoire devant la ministre vendredi, estime, comme la ministre St-Pierre, que la FPJQ fait preuve de corporatisme dans ce dossier. Selon lui, la gestion du titre devrait être confiée à un Comité du statut du journaliste professionnel. «Pour ne pas dénaturer ni discréditer le statut de journaliste professionnel, il faut éviter à tout prix que la gestion de ce statut soit reliée de près ou de loin à quelque groupe d'intérêt. Cela permet d'éviter que des acteurs soient à la fois juges et parties, car les détenteurs du statut de journaliste professionnel seront tantôt des cotisants, tantôt des employés, tantôt des membres et pourraient tenter d'influencer les décisions», écrit-il.
«Si la FPJQ persiste dans sa volonté de regrouper et de représenter les journalistes détenteurs du statut légal de journaliste professionnel, on doit se demander s'il est convenable d'accorder une telle responsabilité à un organisme fondé sur l'adhésion volontaire. À plus forte raison, on conçoit mal que ceux qui détiennent le statut légal de journaliste professionnel soient obligés d'adhérer à un organisme qui ne relève pas des lois professionnelles du Québec. Finalement, il serait risqué que la FPJQ soit le gestionnaire direct ou indirect du statut professionnel de journalistes, car chaque décision risquerait d’affecter son membership et son financement. Une certaine complaisance pourrait s’installer au fil du temps», poursuit l'éthicien.
Son message semble avoir la faveur de la ministre qui a demandé vendredi à la FPJQ d'être moins «rigide» et a martelé que l'objectif de sa consultation publique n'était pas de discuter des pouvoirs de la fédération, mais d'améliorer la qualité de l'information au Québec. Brian Myles n'a pas voulu commenter l'accrochage. «On va faire les remarques appropriées aux interlocuteurs, mais par d'autres canaux que les entrevues», a-t-il indiqué. Au printemps, il avait déjà dû faire face aux critiques de son confrère du Devoir, Louis-Gilles Francœur, et de la Fédération nationale des communications (FNC) qui s'étaient eux aussi opposés à ce que la FPJQ soit la gardienne du titre professionnel. Pour eux, ce rôle devrait plutôt incomber au Conseil de presse du Québec, l'«arbitre ultime en matière de déontologie».
[node:ad]