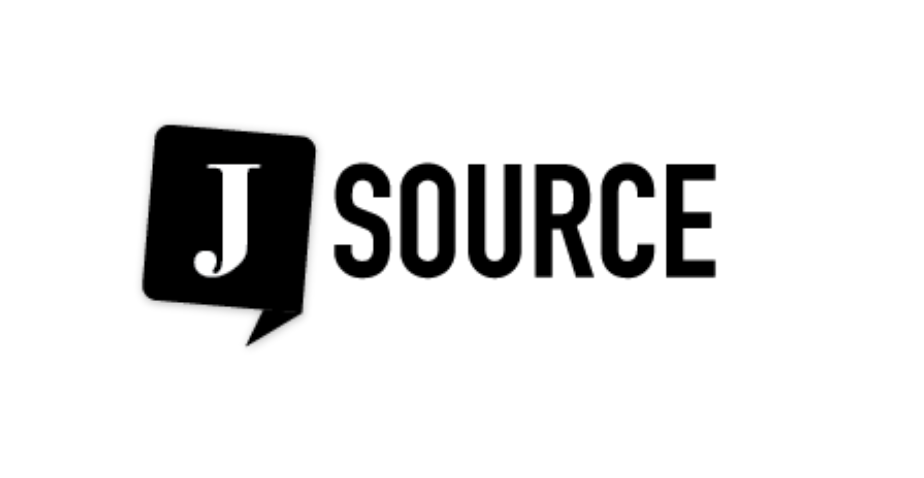Peut-on gagner sa vie avec sa plume? Bien sûr que oui! Mais au-delà de cette réponse positive, dans son dernier livre (Écrire pour vivre, Québec/Amérique, 2007), le journaliste et auteur Jean Benoît Nadeau tourne les coins un peu rond: il décrit le journaliste pigiste et l’auteur comme si ceux-ci étaient des bulles complètement isolées du reste de la planète.
L’éditeur veut réutiliser leurs textes sans les payer à nouveau? Les tarifs au feuillet sont trop bas? C’est d’abord et avant tout la faute des scribes qui ne négocient pas avec assez d’acharnement, selon M. Nadeau.
Malgré tout le mérite qui revient à l’auteur d’avoir produit un ouvrage fort substantiel pour conseiller les gens qui désirent vivre de l’écriture, il est étonnant qu’il ait choisi de ne pas dire un mot sur la concentration de la presse qui a considérablement rétréci le marché, non plus que sur les compressions budgétaires, ou sur le fait que les indicateurs économiques des médias d’information soient au rouge dans pratiquement tous les domaines, sur trois continents.
Selon son analyse, c’est plutôt le journaliste pigiste qui est le seul et unique responsable de ses succès et de ses échecs. C’est le mythe de l’entrepreneur qui, à la seule force du poignet, s’est hissé aux plus hauts échelons.
Certes, tout le monde est d’accord avec les prémisses: pour gagner honorablement sa vie avec sa plume, il faut davantage recycler ses idées, explorer de nouveaux marchés et, surtout, ne pas avoir peur de négocier avec son éditeur.
Mais tout cela est tellement présenté comme une recette de cuisine, que l’on en ressort avec l’illusion que si l’on suit la recette, on va réussir. Attention, il y a une conséquence: si vous échouez, c’est que vous n’avez pas travaillé assez fort! Ou bien que vous n’êtes pas de bons journalistes…
C’est une vision dangereusement simpliste. Dangereuse, parce qu’elle fait reposer le fardeau de l’avenir d’une information libre et indépendante sur les seules épaules des journalistes à statut précaire. Les suppressions de postes dans les salles de rédaction depuis 30 ans, le fait que les nouveaux emplois créés soient majoritairement à durée limitée ou à la pige, le fait que, dans les pays riches, de moins en moins de gens achètent un journal, l’éparpillement des audiences à la télévision, la montée en force d’Internet et du «journalisme citoyen», rien de tout cela ne semble important quand on croit au mythe de l’entrepreneur.
Le mythe de l’entrepreneur
Si les tarifs payés au journaliste ne sont pas assez élevés, si la paye n’est pas assez bonne, si la commande n’est pas assez longue, si les sujets ne sont pas assez intéressants, c’est toujours, toujours, la faute de celui qui tient la plume. C’est un travailleur indépendant, donc c’est un entrepreneur. Et un entrepreneur n’a besoin de l’aide de personne — surtout pas d’une association comme l’AJIQ (Association des journalistes indépendants du Québec) qui, quelle horreur, prétendrait défendre ses droits! Or, la théorie de l’entrepreneur est-elle valable? On a toujours tenu pour acquis que oui, mais en réalité, on n’a JAMAIS essayé de le démontrer.
Ça devrait pourtant relever du gros bon sens. S’ils étaient tous des «entrepreneurs» et si la seule chose garante du succès, c’était leur talent à écrire et à négocier de plus hauts tarifs, alors la sélection naturelle aurait dû faire son oeuvre. Depuis 30 ans, les meilleurs journalistes indépendants auraient peu à peu pris le haut du pavé et les tarifs à la pige auraient été tirés vers le haut. Or ce n’est pas le cas. Est-ce simplement parce que les Québécois n’osent pas négocier, comme le prétend M. Nadeau? Faux: les tarifs minimaux à la pige, dans la presse écrite au Canada anglais et aux États-Unis n’ont pas bougé non plus depuis trois décennies!
Certains diront que c’est parce que trop de jeunes obtiennent leur diplôme en journalisme, prêts à travailler à n’importe quelles conditions. C’est possible, mais cela, les promoteurs de la théorie de l’entrepreneur n’en parlent jamais.
Certains mentionneront la concentration de la presse. Elle nuit à la qualité de l’information et elle nuit aux conditions de travail des journalistes salariés et précaires, selon différentes études menées notamment par la Fédération internationale des journalistes (2006), la Fédération européenne des journalistes (2003) et la National Writers Union des États-Unis (2001).
Montée du travail précaire
La croissance inexorable du travail précaire se traduit, selon ces mêmes analyses, par un recul du journalisme critique et d’enquête, par davantage de sujets superficiels (ils sont plus lucratifs!) et moins de suivi des dossiers d’importance. Financièrement, la montée du travail précaire se traduit par des revenus moyens qui, au mieux, stagnent par rapport à il y a cinq ans, et au pire, sont à la baisse.
Il est donc difficile de croire que tout ce contexte socio-économique n’a aucune influence sur le journaliste pigiste qui tente de négocier un meilleur tarif! Et le public, dans tout cela? À l’évidence, ce serait loin d’être négligeable s’il protestait quelque peu. Tant que l’état des médias d’information continuera de se dégrader, c’est la qualité de l’information qui lui est offerte qui continuera de se dégrader.
Évidemment, cela n’aide en rien quand les journalistes eux-mêmes donnent l’impression de se sentir peu concernés: la plus grande association de journalistes au Québec, la FPJQ (Fédération professionnelle des journalistes du Québec) s’accroche depuis longtemps à l’idée que les conditions de travail ne font pas partie de son mandat. Le mythe de l’entrepreneur, dans leurs formations offertes aux débutants, envoie à ceux-ci le message qu’ils n’ont pas, eux non plus, à se préoccuper de ces problèmes. Négocie avec ardeur et tout ira bien!
C’est une attitude qui ressemble à celle du personnage qui, sur le Titanic, était si sûr de lui qu’il s’obstinait à envoyer le paquebot sur la route du nord, comme si les icebergs n’étaient qu’une vue de l’esprit. Soit on choisit de se dire qu’il n’y a rien à faire, que le journalisme est irrémédiablement voué à sa perte et qu’il vaut donc mieux en tirer le maximum de fric avant que l’aventure journalistique ne se termine. Soit on relève ses manches pour y changer quelque chose et faire virer le paquebot.
*Cet article publié dans Le Devoir, édition du 26.06.07 a été reproduit ici avec le consentement des auteurs
[node:ad]