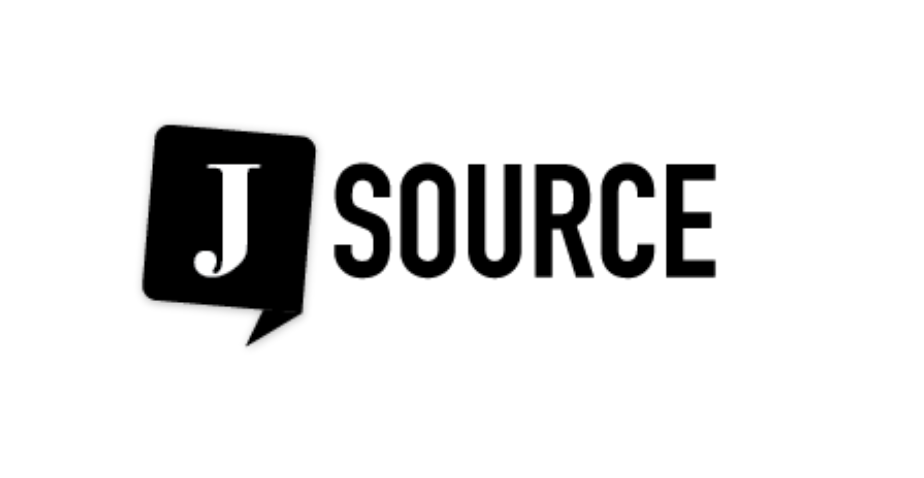Sortir de sa zone de confort
Par Colette Brin
Le travail sur le terrain doit aussi être repensé afin de réduire la distance géographique et psychologique entre les journalistes, leur public cible et les populations défavorisées
Par Colette Brin, originellement paru sur le blogue Contact de l'Université Laval
Tous les étudiants en journalisme apprennent la loi du mort-kilomètre, cette mesure brutale de l’impact psychologique des drames humains. Plus l’événement est éloigné géographiquement, plus le nombre de morts doit être élevé pour justifier qu’on en fasse une manchette.
Le principe est habituellement évoqué pour parler de l’information internationale, mais elle vaut tout autant pour l’information locale. Les journalistes tendent à vivre et travailler plus nombreux dans les grandes villes et même dans certains quartiers plutôt que d’autres, à provenir de la classe moyenne et à partager certaines valeurs sociales.
De sorte que certaines réalités locales, notamment celles des populations plus défavorisées ou marginales et tout particulièrement les communautés autochtones, sont couvertes de manière très occasionnelle, quasi exclusivement sous l’angle du fait divers. Ou encore, lors d’une crise humanitaire ou à l’approche de la période des Fêtes, sous l’angle de l’appel à la compassion, voire à la charité. Ce qui a comme effet pervers, malgré les meilleurs sentiments, de creuser le fossé entre «eux» et «nous», entre les destinataires pressentis de la nouvelle et les principaux intéressés.
Certains médias alternatifs, communautaires ou indépendants –notamment les journaux de rue comme La Quête ou L’Itinéraire– en font une couverture plus suivie et engagée, mais peu diffusée. Dans les grands médias, des chroniqueurs prêtent leur plume, leur sensibilité et leur influence pour ébranler momentanément notre conscience. Des reportages exemplaires –plusieurs d’entre eux gagnent d’ailleurs des prix– nous montrent, après une expédition d’une semaine ou deux, des images saisissantes et des récits poignants de ces contrées exotiques que sont l’Abitibi et la Côte-Nord (!).
Dans le meilleur des cas, on est ému, choqué; on fait circuler le reportage dans notre entourage, on fait un don à la Croix-Rouge pour se donner bonne conscience. Mais cela laisse parfois l’impression d’une exploitation esthétique de la misère et on se demande si c’est suffisant.
Les journalistes sont souvent les premiers à déplorer que ces sujets sont moins vendeurs que le hockey, la télé-réalité ou la cuisine et à se demander comment faire mieux. Il n’y a pas de solution simple. Justement, les automatismes, les traitements faciles et simplistes peuvent contribuer à banaliser la pauvreté, à conforter les perceptions stéréotypées et l’inaction. La complexité et la persistance du phénomène en font par ailleurs un sujet difficile à traiter en 600 mots ou 2 minutes.
Approfondir et rapprocher
Des organisations et des mouvements dédiés à combattre les inégalités sociales peuvent développer leurs propres stratégies de communication et même leurs propres médias. Comme nous l’a montré l’expérience des indignés cet automne, l’ambiguïté du message et l’absence de porte-parole désignés a certainement nui à leur cause.
Les plates-formes numériques offrent l’occasion de renouveler l’écriture et la mise en forme des reportages. Le webdocumentaire et le reportage multimédia, des approches plus participatives et moins linéaires, des cartes interactives sont autant de formes qui peuvent aider à raconter autrement.
Le travail sur le terrain doit aussi être repensé afin de réduire la distance géographique et psychologique entre les journalistes, leur public cible et les populations défavorisées. Pour poursuivre l’analogie avec l’information internationale, l’idéal serait d’aborder la rue, la réserve, la région éloignée comme autant de secteurs spécialisés à investir à long terme plutôt que sous forme d’assignation ponctuelle. On ne peut pas envoyer un journaliste permanent dans chaque secteur défavorisé, mais on peut cibler une zone pour un an ou deux. Certains médias, comme AgoraVox en France, privilégient plutôt la collaboration avec des blogueurs citoyens issus de ces milieux –dans d’autres cas, des étudiants en journalisme– à qui on offre un certain encadrement professionnel.
Il importe de souligner que la plupart de ces initiatives sont soutenues par des médias publics, des subventions gouvernementales ou des fondations philanthropiques. Elles ne sauraient s’inscrire dans une logique strictement commerciale, qui privilégie le rendement à court terme et des contenus qui procurent des émotions –et des satisfactions– tout aussi éphémères. Une grande partie du journalisme de qualité dépend d’ailleurs de la résistance à cette logique, voire à sa subversion.
Merci à mes collègues Greg Nielsen, du Département de sociologie et d’anthropologie à l’Université Concordia, et Jean Charron, du Département d’information et de communication de l’Université Laval, pour les échanges qui ont nourri ce texte.
Colette Brin est professeure titulaire au Département d'information et de communication de l'Université Laval et membre du comité éditorial de ProjetJ.
[node:ad]